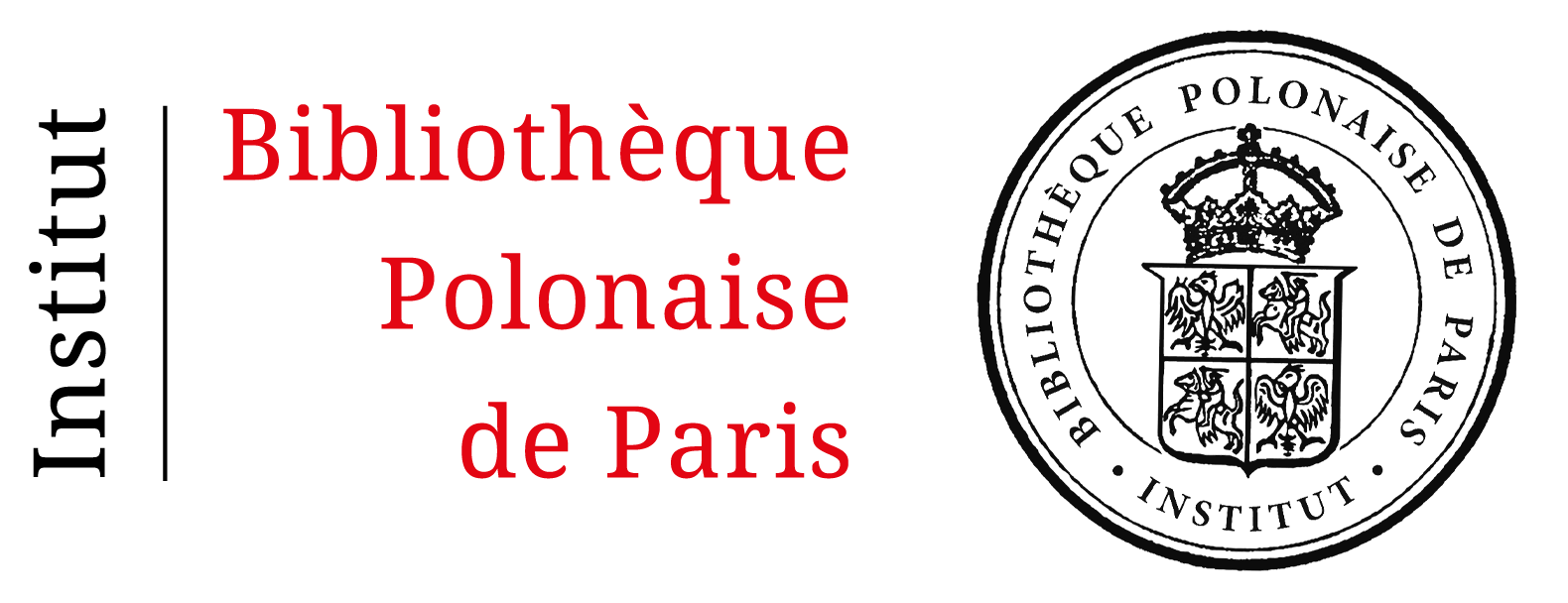Expositions temporaires
-

OLGA BOZNAŃSKA (1865-1940)
OLGA BOZNAŃSKA (1865-1940). Philosophie du portrait
Vernissage de l’exposition – le vendredi 4 avril 2025 de 19h à 21h
Invitation (pdf)
EXPOSITION OUVERTE
du mardi 8 avril au vendredi 30 mai 2025
du mardi au vendredi de 14h à 18h
17 mai (Nuit des musées) 16h-21h
fermée le 1, 8, 29 maiCroquis de femmes en chapeaux, crayon (détail).
N° inv. Rys. 023.16, Collections artistiques IBPPCracovie, Munich et une jeune fille aux chrysanthèmes
Olga Boznańska est née à Cracovie, dans une famille aristocratique. Son père, Adam Nowina-Boznański (1836-1906), issu d’une famille de petits propriétaires terriens, prend part à l’Insurrection de Janvier 1863. Il étudie à Vienne, puis en France, où il rencontre une Française, Eugénie Mondant (1832-1892), professeure diplômée, future épouse et mère d’Olga. Le 15 avril 1865 naît Olga dont les talents artistiques se manifestent dès son plus jeune âge. Elle apprend d’abord le dessin sous la direction de sa mère. « J’étais une petite fille de six ans et je dessinais déjà », se souvient l’artiste. Plus d’une dizaine de charmants pastels représentant des bergers, des fleurs et des religieuses datent de cette période. Tous sont signés par Olga du nom de son père « Nowina ».
Sa formation d’artiste débute à Cracovie. Son premier professeur est Józef Siedlecki, collectionneur, artiste, une personnalité singulière, qui incite Boznańska à tout copier, en particulier les reproductions de tableaux de sa propre collection qui sont éditées par le marchand parisien d’art Adolphe Goupil. Dans les années qui suivent (1884-1885), elle se forme, en suivant les cours supérieurs pour femmes d’Adrian Baraniecki (le « Baraneum »). Hipolit Lipiński (1846-1884) lui enseigne la peinture de paysage, Antoni Piotrowski (1853-1924) l’étude d’après un modèle vivant, et Konstanty Maria Górski (1859-1924), critique d’art et historien, les bases de l’histoire de l’art. Leurs enseignements ont eu une influence considérable sur la jeune artiste en devenir.
C’est à la même époque qu’elle décide d’élargir ses horizons. La ville de Cracovie est certes tenue pour un formidable foyer artistique, la ville du décadentisme à la Maeterlinck (1862-1949), de Zenon Przesmycki « Miriam » (1861-1944) ou de Stanisław Przybyszewski (1868-1927), cette mélancolie traverse les œuvres de Boznańska, mais l’artiste ne s’arrête pas là, elle est toujours à la recherche de la perfection dans le maniement de la matière picturale. Ainsi, bien que Cracovie soit le lieu de son premier atelier indépendant, le peintre se rend à Munich, après seulement quelques mois de cours au Baraneum (au milieu de l’année 1885). C’est là que Boznańska s’installe pour douze ans, jusqu’en 1898 et c’est en ces termes qu’elle évoque sa formation : « Je peignais avec acharnement du matin au soir, je ne sortais presque pas, vivant de l’enthousiasme pour l’art ».
À cette époque, l’artiste étudie les peintures de Diego Velázquez (1599-1660) dont les originaux sont conservés à l’ancienne Pinacothèque de Munich. Olga habite à distance d’une simple promenade de l’ancienne Pinacothèque, elle y est un visiteur assidu. Outre Velázquez, l’attention de l’artiste se porte sur l’œuvre d’Antoon van Dyck (1599-1641), elle produit des copies du Portrait du peintre Pieter Snayers et la Descente de la Croix ainsi que d’autres copies des maîtres anciens qui se trouvent aujourd’hui dans les collections de la Bibliothèque Polonaise de Paris).
Parmi les tableaux de l’époque munichoise se distingue la Fille aux chrysanthèmes (1894), le véritable crédo de l’artiste. Se stabilise aussi la gamme des gris, des bruns, des noirs, des verts, des blancs et des roses. Naissent également ses premières interprétations de la tradition picturale qui vont désormais constituer l’élément constant du langage et des thèmes abordés dans son œuvre, à savoir le portrait individuel, la maternité, l’image de l’enfant ou l’atelier de l’artiste. Le japonisme, populaire alors à Munich, influence le symbolisme de l’univers visuel de Boznańska : qu’il s’agisse d’une fleur dans la main d’une petite fille ou d’un cadrage serré comme dans les estampes Ukyo-e. La peintre utilise aussi, pour la première fois, les moyens photographiques dans le contexte de ses recherches autour du portrait.
Un portrait privé des mains est une invention de la photographie. Quel plaisir de peindre une main, surtout quand elle est belle, sèche, veinée, avec de longs doigts ! Chaque main possède son expression, son tempérament, son caractère. Elle est le complément psychologique du visage.
Boznańska consigne la réalité munichoise dans ses carnets de croquis. Leurs pages sont remplies de paysages arborés et de croquis éclairs de personnages, de silhouettes, de passants, comme en témoignent les dessins de cette période. Elle développe aussi la technique du pastel, élément important dans la construction de la matière colorée d’un tableau, particulièrement important dans le cadre de ses études de portraits. L’œuvre de James Abbott McNeill Whistler (1834-1903) vue lors de l’exposition de Munich complète les sources d’inspiration et ses repères artistiques. Dans les portraits de cette période, on trouve des références directes au peintre anglais, tant pour le choix de la composition – portrait en pied – que dans la mise en forme de l’espace pictural : emploi d’un fond uni, avec de larges aplats de couleurs, vaguement délimités. Avec son attrait pour l’introspection psychologique commence la plus longue étude picturale dans la vie de l’artiste, à savoir celle de son propre visage. À Munich débute une série de plus de trente autoportraits que Boznańska réalisera jusqu’à la fin de sa vie.
Paris pour toujours ?
Boznańska, artiste formée déjà, arrive à Paris et y passe quarante-deux ans de sa vie. Changeant trois fois d’adresses, elle reste toutefois fidèle au quartier du Montparnasse. La première exposition de son travail, à la galerie Georges Thomas, présente vingt-quatre œuvres de l’artiste, principalement des portraits à l’huile, mais aussi des natures mortes et des esquisses à l’aquarelle.
Nous savons que la peintre suivait sa propre stratégie d’exposition, minutieusement élaborée. Outre les expositions chez des marchands d’art familiers, ceux qui comprenaient son art, Boznańska privilégiait les salons et les grandes expositions internationales. Au Salon de la Société nationale des beaux-arts, elle expose pour la dernière fois en 1927, et au Salon des Tuileries en 1930. Elle participe volontiers à des expositions réservées aux femmes peintres et sculpteurs, comme en témoigne l’exposition du collectif Les Quelques en 1909, 1910, 1913 et 1929, ou sa participation à celle de la galerie Reitlinger. Dans les années 1930, Boznańska rejoint le groupe FAM (Les femmes artistes modernes) qui accueille d’autres Polonaises dont A. Halicka, T. Lempicka et M. Muter.
À Paris, Boznańska n’est jamais seule. Son atelier-œuvre reçoit les visites de femmes artistes, de musiciens, d’écrivains, il est aussi un véritable jardin zoologique (deux chiens, un perroquet et des souris apprivoisées). Toujours en 1902, à Montparnasse, Olga fait la connaissance du jeune sculpteur Boleslas Biegas. Ce dernier vient d’arriver à Paris. Inspiré par leur rencontre, le sculpteur réalise peu après un buste de Boznańska qui sera montré lors de la XVIIe exposition de l’Art Nouveau (Sécession) à Vienne. Désormais, la peintre entretiendra une relation amicale avec Biegas, et plus tard, elle deviendra proche du couple de ses mécènes, Jadwiga et Henryk Trüschtel. Olga peint leurs portraits. Dans la collection de l’Institut Bibliothèque Polonaise de Paris, six œuvres d’Olga Boznańska proviennent de l’héritage de Bolesław Biegas.
L’expositions Cent tableaux qui se tient en 1909, dans la galerie du Petit Musée Beaudoin (au 253 rue St. Honoré), où Boznańska présente ses peintures, suscite chez elle une vive sensation dont elle parle à une de ses amies :
Mes peintures sont belles parce qu’elles sont vraies, honnêtes, dignes d’une dame, il n’y a pas de mesquinerie là-dedans, pas de maniérisme, pas de fadeur. Elles sont calmes et vivantes, comme si un léger voile les séparait des spectateurs. Elles ont leur propre atmosphère. J’ai exposé 30 tableaux, j’aurais pu en exposer deux fois plus, mais il n’y avait pas eu de place. Une salle très noble, une lumière magnifique, des murs tapissés de velours gris, d’une couleur « très discrète».
À Paris, Boznańska choisit consciemment le portrait comme terrain d’expérimentation picturale. C’est également le portrait qui lui assure un nombre constant de commandes et une reconnaissance adéquate. Au fil du temps, elle assoit sa réputation sur le marché de l’art, le gouvernement français commence à acquérir ses œuvres, on lui demande d’exécuter le portrait de personnalités importantes comme Natalie Barney, Pierre Tournier, Edouard Franchetti et Arthur Rubinstein. L’artiste revient toujours à Cracovie où se trouve sa maison familiale, dont elle s’occupe après la mort de son père. Bien qu’elle hésite à plusieurs reprises à retourner en Pologne, elle ne se décide jamais à quitter Paris, même quand on lui propose à deux reprises un haut poste à l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie. Dans une lettre à son père, elle en parle sincèrement.
Je suis heureuse que l’affaire de l’Académie de Cracovie soit terminée, et je ne sais même pas comment en remercier Dieu, et puis M. Fałat. Maintenant, je peux me rendre à Cracovie sans crainte ; jusqu’à présent, je tremblais rien qu’à l’idée de tomber entre les mains de toute cette bande qui m’envie ma liberté et mon prétendu bonheur… Je ne me sens pas, et je ne me suis jamais sentie obligée de sacrifier ma peinture et moi-même pour quelques sottes et pompeuses demoiselles qui, faute d’autre chose à faire, s’adonneraient à l’art. Pour faire cela, je prends ma profession trop au sérieux… j’ai ce bonheur, et je n’en veux pas d’autre au monde ; dès que je ne pourrais plus peindre, je devrais cesser de vivre.
En 1938, à l’invitation du commissaire du Pavillon polonais, Mieczysław Treter (1883-1943), Boznańska participe à la 21e Biennale de Venise, où elle expose vingt-sept œuvres. Cette exposition a lieu deux ans avant la mort de l’artiste. Cinq tableaux sont vendus pendant l’exposition, dont l’un, Portrait de Constance Dygatowa, est acheté par le roi Victor Emmanuel III d’Italie, pour la collection de la Galleria Internazionale d’Arte moderna – Ca’ Pesaro, de Venise. Au cours de sa vie, Boznańska a peint plus de 3 000 tableaux. La majeure partie de ses œuvres et de ses archives (épistolaires et photographiques) est conservée au Musée national de Cracovie. Les peintures que nous présentons à l’Institut Bibliothèque Polonaise de Paris ne sont qu’un aperçu de l’ensemble, mais c’est un extrait symbolique qui résume la richesse de la quête artistique d’Olga Boznańska et de sa vie passée entre Cracovie, Munich et Paris.
Expositions précédentes:
-

SIUDMAK. SCULPTEUR
SIUDMAK. RZEŹBIARZ
Durée de l’exposition 28.02.2025 au 28.03.2025
Wojciech Siudmak – peintre, dessinateur, sculpteur. Né le 10 octobre 1942 à Wieluń, il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie ainsi qu’à l’École des Beaux-Arts de Paris. Depuis 1966, il vit et crée en France. Considéré comme l’un des principaux représentants du réalisme fantastique, il est également associé au courant naissant du néo-surréalisme. Il est l’un des artistes liés à la Pologne les plus connus. Ses oeuvres sont répandues dans le monde entier : elles apparaissent sur des couvertures de livres et d’albums ainsi que sur des affiches de films et d’événements scéniques. Son travail a fasciné des figures telles que Federico Fellini ou George Lucas, et actuellement Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune, film primé aux Oscars. Il est le créateur du Projet Mondial la Paix. Ses peintures, dessins et sculptures ont été présentés lors de plus d’une centaine d’expositions, principalement individuelles, en Europe et en Amérique du Nord.
Au coeur de Paris, sur l’île de Saint-Louis, lieu privilégié de l’histoire et de la culture polonaises, cet événement est la première exposition entièrement consacrée à l’oeuvre sculpturale de l’un des plus éminents artistes vivants associés à la Pologne, Wojciech Siudmak. L’artiste pratique cette discipline depuis la fin des années 1970 et, à côté de la peinture et du dessin – pour lesquels il est le plus connu du grand public – c’est la sculpture qui est son principal moyen d’expression artistique. L’exposition présente de nombreux moulages en bronze ainsi que des modèles et des prototypes. Les sculptures sont accompagnées de dessins et d’esquisses, révélant le processus de formation d’idées, de thèmes et de compositions surréalistes, que l’artiste ensuite concrétise dans l’espace. Les sculptures de Wojciech Siudmak, comme l’ensemble de son oeuvre, constituent une sorte de pont poétique entre l’héritage des maîtres anciens, le symbolisme et le surréalisme, et ce qui est présent, futur et encore inconnu.
-

Gombrowicz et la France
GOMBROWICZ ET LA FRANCE,
Prendre par les cornes le taureau de la supériorité occidentale !27.11 – 31.01 du mardi à vendredi – 14h00 – 18h00
GOMBROWICZ I FRANCJA,
Złapać za rogi byka wyższości zachodniej!27.11 – 31.01 od wtorku do piątku – od 14:00 do 18:00
Gombrowicz, dès son premier séjour en France cherche y trouver sa place et être reconnu sa juste valeur quand il est étudiant Paris en 1928, ensuite en tant qu’écrivain quand il revient en Europe en 1963 après son exil argentin. De son premier séjour il note dans Souvenirs de Pologne : « J’ai pris pour la première fois par les cornes ce taureau auquel j’ai dû m’affronter plus d’une fois par la suite, le taureau de la supériorité occidentale ! ». Dans sa vie d’écrivain, il essaie d’établir une vraie stratégie de lutte pour la gloire, avec l’aide du cercle des intellectuels polonais de Kultura Institut Littéraire et des éditeurs et critiques français. La France devient par la suite non seulement l’endroit où l’accomplissement et la reconnaissance de son œuvre sont possibles mais aussi le pays que Gombrowicz choisit pour y passer les dernières années de sa vie.